Mathilde Marmier, originaire du Haut-Doubs, est la nouvelle directrice générale de l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. La médecin en santé publique balaie les principaux dossiers qui font l’actualité de la structure.
C’est à dire : Mathilde Marmier, vous assurez la direction de l’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté depuis le 31 juillet. Alors que la coopération s’accentue entre le C.H.U. et les établissements tels que Pontarlier, doit-on craindre la disparition des petits hôpitaux de proximité, comme ceux de Morteau, Mouthe, Ornans ?…
M.M. : Il y a deux sujets différents. D’abord, les hôpitaux de Morteau, Ornans et Mouthe sont labellisés « hôpital de proximité ». C’est un statut de structure très sécurisant pour les établissements de petite taille. C’est un label qui a deux objectifs : d’une part, garantir un certain niveau d’offres, avec à la fois des consultations avancées, quelques lits d’hospitalisation, une mission de prévention. Et d’autre part, ce label s’accompagne d’un modèle de financement spécifique qui vise à sécuriser sur le plan financier ces établissements particuliers. 31 hôpitaux en B.F.C. sont labellisés hôpital de proximité. La tendance du système de santé est dans la gradation des soins, c’est-à-dire favoriser la coopération entre les établissements. On part de l’hôpital de proximité qui fait du soin de recours, au plus près des personnes. Dès que ça devient compliqué, il y aura le C.H.U. à l’autre extrémité. C’est un système plutôt vertueux.

Cette dynamique entre les territoires permet également d’avoir un appui parfois de professionnels du C.H.U. qui vont se déplacer à Pontarlier pour pouvoir assurer une prise en charge de proximité, y compris des spécialistes.
On est sur nos deux pieds, avec le fait de maintenir une offre en proximité et favoriser par ailleurs les coopérations pour avoir une gradation des soins et maintenir certaines spécialités en proximité.
Càd : A l’hôpital de Pontarlier, le poste de directeur est vacant depuis plus d’un an. Thierry Gamond-Rius, directeur général du C.H.U. de Besançon en assure l’intérim. Ce dernier est favorable à une direction commune entre les deux établissements, qui garderait pour autant chacun leur autonomie. La décision est entre les mains de l’A.R.S. Y êtes-vous favorable ?
M.M. : On prend cette décision avec les acteurs locaux, il faut que ce soit accepté sur place, on prend les avis des présidents du conseil de surveillance qui sont les maires de Pontarlier et Besançon. La proposition de M. Gamond-Rius est aussi de trouver une solution qui puisse être acceptable par la communauté médico-soignante. On regarde tout ça pour prendre une décision.

Càd : Quand cette décision sera prise ?
M.M. : Elle sera prise dans les prochaines semaines.
Càd : Quelle est la problématique la plus prégnante dans la Région B.F.C. en termes de santé ?
M.M. : Il y a une forte attention politique sur le sujet de l’accès aux soins. C’est un sujet fortement porté par nos ministres sur le Pacte de lutte contre les déserts médicaux (annoncé au printemps dernier, N.D.L.R.) Plusieurs mesures sont en place dont une récente : les médecins solidaires. Cette mesure consiste à identifier des zones rouges prioritaires. On en a 14 dans la région. Au sein de ces zones rouges, des médecins généralistes qui n’exercent pas dans ces zones peuvent venir deux jours par mois avec une rémunération supplémentaire. Les lieux permettant d’accueillir ces consultations sont en train d’être stabilisés. On est en train de déployer tous nos efforts pour identifier le plus possible de médecins volontaires pour aller dans ces zones. La mobilisation continue, on passe d’ailleurs un appel aux médecins qui seraient intéressés.
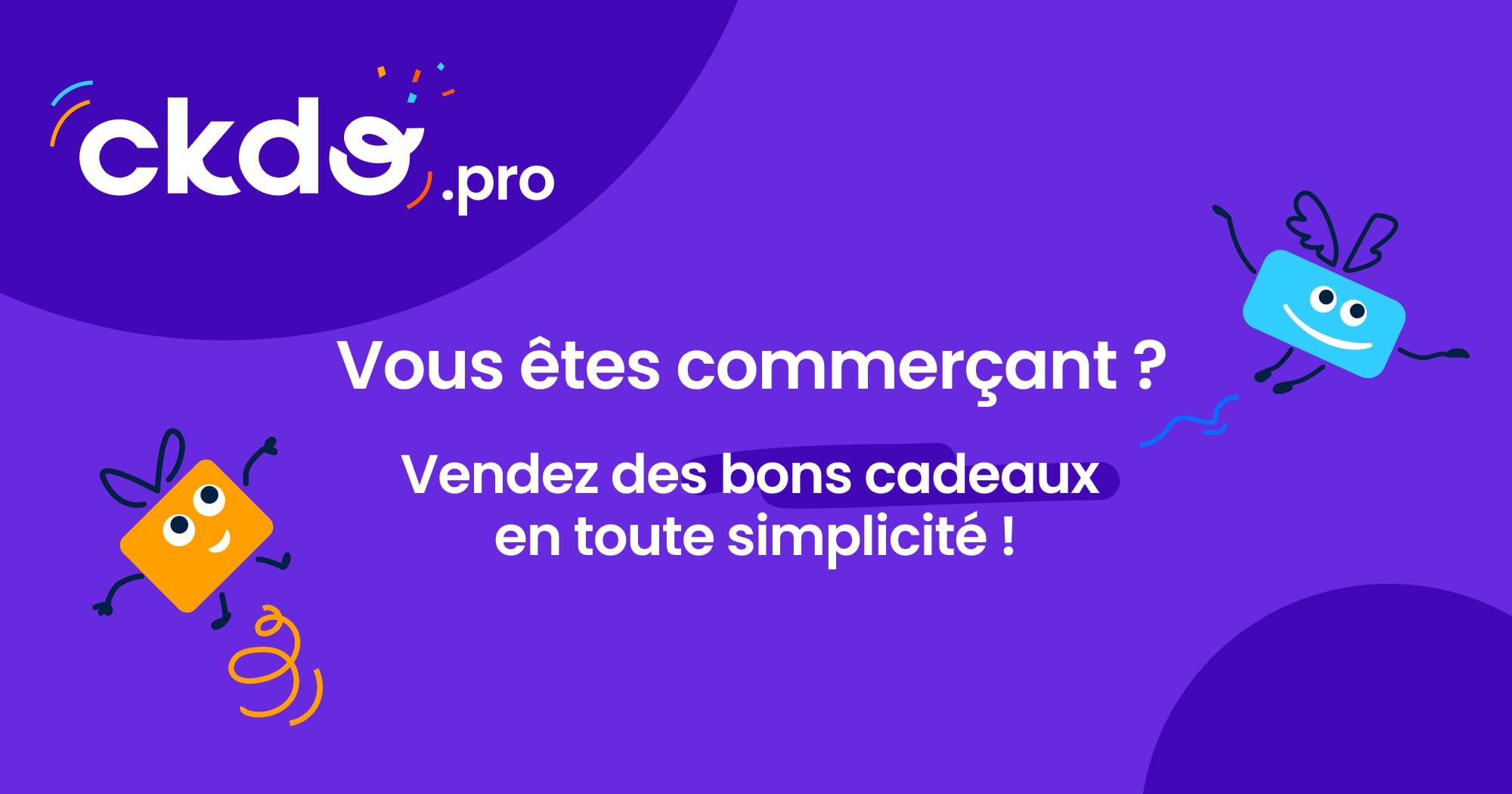
Une deuxième mesure se mettra en oeuvre plus tard, en novembre 2026, c’est celle des Docteurs juniors, les étudiants en quatrième année de médecine pour les internes de médecine générale. Soit une année supplémentaire d’internat qui a été instaurée et qui vise à ce que ces internes soient en relative autonomie et puissent représenter une offre de soins supplémentaire. On est en train de mobiliser des maîtres de stage pour les accueillir et en être responsables. Ces internes sont rattachés à un médecin mais peuvent consulter en autonomie. Au-delà d’une certaine activité et s’ils vont dans une zone prioritaire, ils auront une valorisation financière.
Pour terminer sur le sujet des déserts médicaux, nous avons aussi des mesures qui préexistaient au Pacte de lutte contre les déserts médicaux et qui continuent. Notamment les aides à l’installation pour les médecins qui sont financés dans le cadre de leur convention avec l’Assurance maladie. On va réviser d’ici la fin de l’année le zonage avec les zones d’intervention prioritaire. D’autres mesures existent aussi plus spécifiques à la Bourgogne-Franche-Comté. Comme le plan d'attractivité pour les professionnels de santé en lien avec le Conseil régional et la Préfecture.
Càd : En quoi consiste ce plan ?
M.M. : Il y a la mise en place de la première année d’études de santé dans plusieurs départements, y compris dans des antennes délocalisées. On finance aussi dans la région des dispositifs pour favoriser l’accès à des soins de spécialistes via la télé-expertise. 20 spécialités comme la dermatologie sont concernées dans la région. Cela permet de favoriser les échanges médecins-médecins. Par exemple, vous consultez un généraliste et il peut avoir facilement accès à l’avis d’un spécialiste, ce qui permet d’optimiser le recours à un spécialiste. Cela existe également entre les établissements de santé.
Càd : La région est-elle attractive pour les professionnels de santé ?
M.M. : D’une part, on a un enjeu démographique de la population de la région. Les professionnels de santé, notamment médicaux, sont vieillissants. C’est un vrai sujet de préoccupation dans la plupart des départements. Le Doubs est dans une situation un petit peu différente. C’est le seul département de la région qui continue à gagner de la population. Et il a la spécificité de la bande frontalière qui rend difficile le recrutement des paramédicaux avec la concurrence de la Suisse.
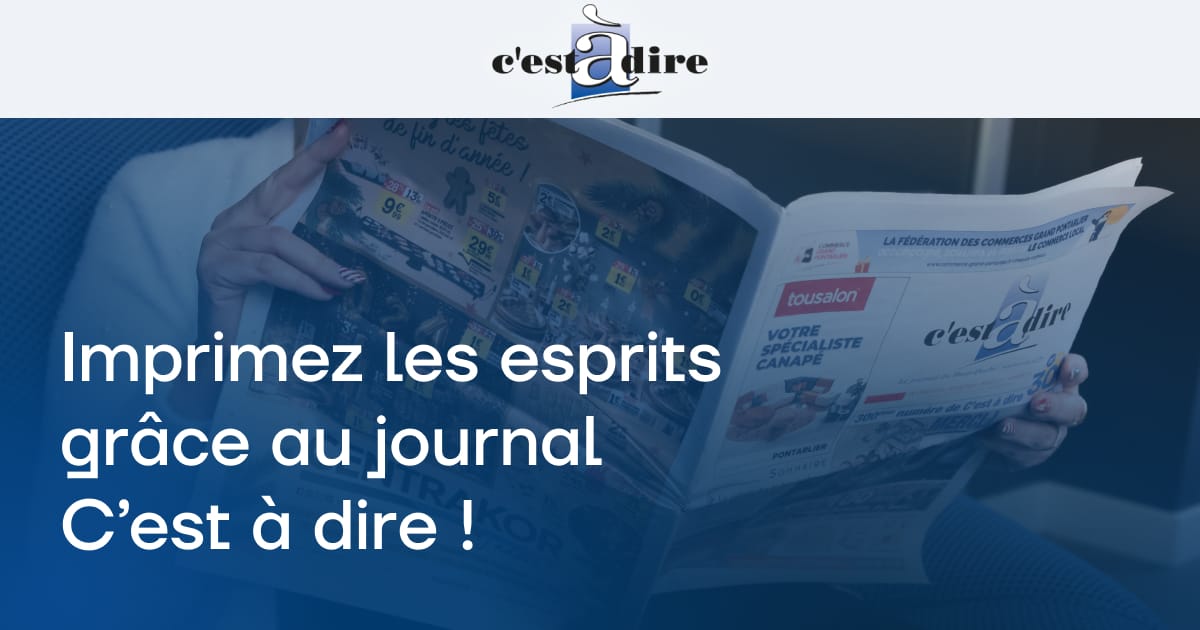
On a un plan d’action avec le conseil régional qui consiste à communiquer sur les métiers et susciter des vocations, avec la mise en place de bourses d’études pour favoriser l'inscription dans les études de santé. Nous avons aussi les premières années d’études de santé délocalisées. Nous venons d’inaugurer à Chalon-sur-Saône qui accueillera ses premiers étudiants l’année prochaine.
Càd : Concrètement, comment cette délocalisation s’applique ?
M.M. : Vous habitez à Chalon-sur-Saône, vous n’avez pas d’université dans votre ville, vous avez accès à une première année d’études dans votre ville avec des cours à distance. Des étudiants qui habitent à proximité de Chalon-sur-Saône, plutôt que de devoir déménager, peuvent suivre leur cours directement dans des locaux à Chalon-sur-Saône avec un système de tutorat des étudiants et des médecins. L’idée est de faciliter l’entrée dans le système avec une première année qui est difficile, mobilisatrice de temps. Cela permet aussi une transition entre le lycée et la suite des études. Il s’agit aussi de démocratiser l’accès à certaines filières. Autre initiative locale qui favorise les étudiants, la maison des internes et des soignants à Morteau pour l’hébergement des étudiants. Il y a aussi toutes les dynamiques territoriales pour que les professionnels et étudiants aient envie de travailler à un endroit, que ce soit les C.P.T.S. (communautés professionnelles territoriales de santé), les maisons de santé. Il y a une grosse dynamique dans le Doubs.
