Professeur agrégé à l’I.U.T. de Belfort-Montbéliard, Guillaume Jehannin est le responsable du diplôme d’université (D.U.) “Laïcité et République”. Il y forme notamment les imams qui enseignent en France. À l’occasion des 120 ans de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, il fait le point sur cette question bien française.
C’est à dire : Depuis quand existe ce D.U. dans notre région ?
Guillaume Jehannin : Ce D.U. a été créé en 2019, il y en a une vingtaine de ce type en France. Au départ, il avait été créé pour former les aumôniers de prison, des hôpitaux et de l’armée. Mais pas que. Il peut aussi concerner des personnels de la gendarmerie, d’administrations, d’entreprises privées, d’associations, et donc les imams qui viennent de l’étranger. Ces derniers sont désormais obligés d’avoir ce D.U. pour être rémunérés en France. Depuis 2021 et la loi “séparatisme”, c’est la fin des imams détachés venus de l’étranger et financés par des pays étrangers. L’objectif global de cette formation de neuf mois est de permettre un approfondissement transdisciplinaire de la laïcité et de la gestion des faits religieux afin de comprendre les principes sur lesquels doit reposer la résolution de cas concrets rencontrés dans la vie professionnelle. Chaque année, nous avons entre 15 et 20 personnes qui suivent ce D.U., cette formation est finançable par le C.P.F., elle est de 130 heures.

Càd : La laïcité touche tous les pans de la vie quotidienne ?
G.J. : Oui, elle est parfois vécue comme une contrainte, pourtant elle est une chance. Dans l’armée par exemple, la République française prend beaucoup de précautions par rapport à cela. Dans les opérations extérieures, elle peut désormais prévoir des menus différenciés, hallal, casher ou autres. On apprend aux étudiants ce à quoi ils ont droit et la façon dont est appliquée la laïcité en France.
Càd : L’islam de France est-il donc mieux défini qu’avant ?
G.J. : J’ai assisté à plusieurs Assises Territoriales de l’Islam de France (A.T.I.F.), comme cette récente session à Besançon et je constate une progression d’année en année de la compréhension mutuelle de ces questions. J’attribue cela au fait qu’on a affaire désormais à des nouvelles générations, plus diplômées, plus habituées à la vie en France, qui savent se faire entendre et revendiquer leurs droits, qui connaissent aussi leurs devoirs et qui sont capables de discuter avec l’administration.
Càd : Loi de 1901 sur les associations, loi de 1905 sur les associations cultuelles, loi de 1907 sur l’exercice public des cultes. De l’extérieur, c’est très difficile à comprendre !
G.J. : Oui en apparence en effet mais c’est finalement assez logique. Une association a ses adhérents mais une association cultuelle, dans le culte catholique du début du XXème siècle, c’est l’évêque qui dirige l’association. Il a donc fallu trouver une forme de structure où c’est l’évêque, et non les adhérents, qui est maître à bord. Tout cela a mis du temps à bien fonctionner et on a dû s’adapter aux autres religions au fil des décennies. L’islam est une religion très récente en France et elle est arrivée dans une période tellement complexe d’après-décolonisation. L’islam n’est pas une religion structurée comme le catholicisme, il a donc fallu du temps pour qu’elle se structure. Et la période plus récente avec l’Afghanistan, l’Iran, les attentats islamistes, tout cela a rendu le contexte encore plus complexe et je trouve néanmoins que dans ce contexte, on s’en tire plutôt bien et je crois qu’on peut faire confiance à cette religion musulmane pour traverser ces difficultés.
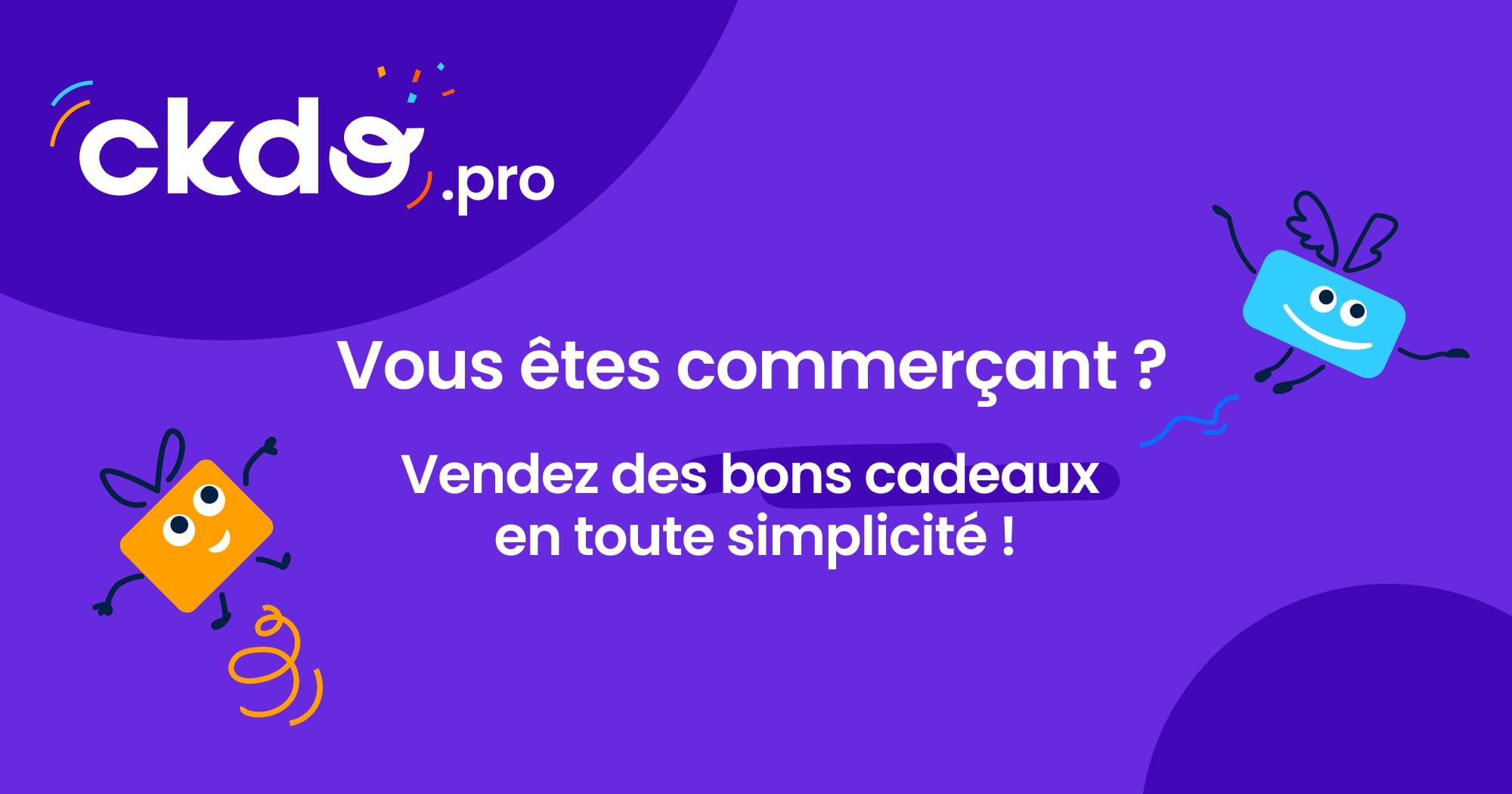
Càd : L’islam est donc bien compatible avec la République ?
G.J. : L’islam s’adapte à nos règles et pour cela, la nouvelle génération a fait de gros efforts. Des éléments comme le halal, c’est récent, c’est le fait d’une génération qui essaie aussi de trouver ses marques. Dans ce contexte, les autres religions, notamment la religion catholique, ont raison de marquer leur territoire aussi. Le fait que dans la restauration collective on ne trouve parfois que du poulet hallal, ce n’est pas normal. On peut s’interroger et dire que ça va trop loin. Sur tous ces points, on est en train de trouver les points d’équilibre avec toute l’histoire qui est la nôtre.
Càd : La laïcité à la française est-elle la bonne formule ?
G.J. : C’est un système qui n’est pas si spécifique à la France. La séparation des Églises et de l’État dans les autres pays existe aussi, elle a juste des formes un peu différentes. Aux États-Unis, même si le président jure sur la Bible, il ne peut pas déclarer la guerre au nom de Dieu ! En France, il a fallu qu’on mette à distance la religion, dans la forme c’est différent, mais le principe est le même. Et elle évolue. Souvenons-nous quand l’abbé Pierre était député, il venait à l’Assemblée en soutane. Ce n’est plus possible aujourd’hui, je pense qu’on n’a pas envie d’avoir un imam à l’Assemblée nationale, il faut donc ajuster les choses progressivement. On essaie d’avoir une intelligence de la laïcité en France et j’avoue qu’être intelligent, ce n’est pas toujours facile ! Tout cela demande une grande écoute, de la délicatesse et de la souplesse. Le principe de la loi de 1905 est toujours le bon 120 ans plus tard, mais il demande toujours des adaptations car la société française a complètement changé depuis 1905. Nous sommes désormais dans une société complètement sécularisée.
Càd : Votre avis sur la question du voile ?
G.J. : Ce sujet fait débat car on essaie de trouver ce qui convient le mieux. Avant 2004, il n’y avait pas de loi, on faisait avec. Peut-être que dans 20 ans, il n’y aura plus besoin de loi car on aura trouvé nos marques. Le principe de la laïcité reste le même, mais ses formes peuvent changer car la société change. On voit aussi des gens qui essaient d’instrumentaliser cette laïcité. Or, elle ne doit en aucun cas être un étendard. La laïcité est un principe ferme, mais humain. Le problème en France, c’est qu’il y a des gens qui n’ont pas envie d’éclairer les débats…
