Depuis septembre dernier, le substitut du procureur Lucas Maillard- Salin a remplacé Claire Keller comme référent du Pôle régional de l’environnement (P.R.E.) au tribunal judiciaire de Besançon. Aux côtés d’Anouk Rozzi, assistante spécialisée, il a siégé à sa première audience dédiée aux atteintes de l’environnement.
C’est-à-dire : Quelle est la différence entre une audience dédiée aux atteintes environnementales et une audience de droit commun ?
Lucas Maillard-Salin : Les affaires se situent entre le contentieux classique du droit commun et les contentieux dits techniques. Le raisonnement n’est pas toujours le même, les débats sont plus techniques, il y a l’appréciation du droit en lui-même. Et s’ajoute le droit administratif de l’environnement. On est au carrefour du droit administratif et du droit pénal.

Càd : Anouk Rozzi, vous êtes arrivée au sein du P.R.E. il y a un peu plus d’un an comme assistante spécialisée. Quel est votre rôle ?
Anouk Rozzi : J’assiste le magistrat du parquet, je prépare le dossier, j’aide à la décision, s’il y a une alternative aux poursuites, laquelle, etc. J’ai aussi la fonction d’animation du réseau en lien avec les substituts des autres parquets, les associations qui peuvent se porter partie civile.
L.M.-S. : C’est un renfort bienvenu. Elle est la mémoire du P.R.E. Elle assure une permanence dans le suivi des dossiers. Le principe du P.R.E. est que chaque parquet de compétence territoriale a chasse gardée sur son ressort. Mais pour une délinquance environnementale qui nécessite une spécialisation, sur les dossiers les plus complexes, les plus techniques, je peux prendre l’ascendant. À la demande des autres parquets ou je décide de demander le transfert de certains dossiers.
Càd : Vous parlez d’alternatives aux poursuites. Quelles sont-elles ?
L.M.-S. : À une extrémité, il y a le classement sans suite ou le classement sous conditions, c’est-à-dire que l’on demande aux gens de faire quelque chose. À l’autre extrémité, il y a les poursuites. Entre les deux, il y a les alternatives. On a la composition pénale qui est comme le classement sous conditions, en plus formel. Pour les atteintes à l’environnement, il y a 19 mesures ainsi que la réparation des préjudices : l’amende de composition, un stage de citoyenneté avec une association pour une sensibilisation à l’environnement, des travaux non rémunérés pour la réparation du dommage par exemple. Ce sont des mesures alternatives qu’on utilise assez largement. Ensuite, il y a la C.J.I.P. (convention judiciaire d’intérêt public). Celle-ci peut être appliquée seulement pour des contentieux de l’environnement, de l’économie, du financier. C’est plus confidentiel, la société incriminée s’engage dans une voie plus conciliante. Et formellement, cela évite une déclaration de culpabilité. Le Parquet s’occupe de l’ensemble des négociations, tout reste à la main du Parquet. Un magistrat de siège valide seulement la C.J.I.P. avec les deux parties.
Que ce soit la composition pénale ou la C.J.I.P., l’objectif est d’arriver à la remise en état du milieu, d’une manière ou d’une autre. Le premier enjeu du P.R.E. est d’arriver à réparer les atteintes. Les peines encourues peuvent être des amendes mais un certain nombre de délits sont passibles de peines d’emprisonnement.
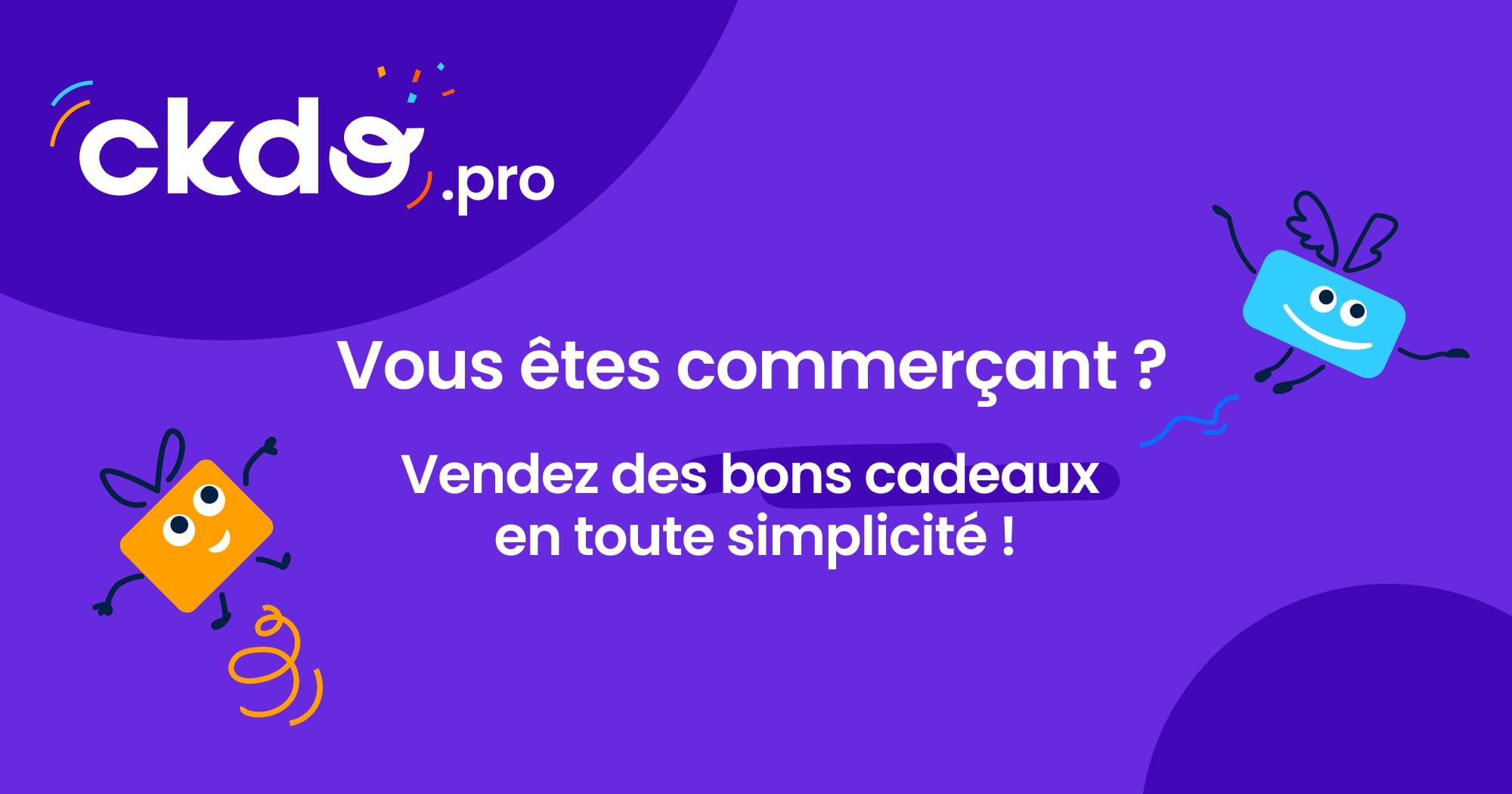
Càd : Que représente le contentieux environnemental par rapport aux autres contentieux ?
A.R. : Il représente environ 1,5 % des contentieux globaux. Au P.R.E., nous avons une soixantaine de dossiers en cours.
L.M.-S. : En comparaison, pour un parquetier, en France, en moyenne, c’est 2 000 procès-verbaux de manière générale. Surtout, l’intérêt du P.R.E. est qu’il n’est pas lié aux contingences politiques. Le Parquet ne sera pas dissuadé d’aller regarder vers le tissu économique local, on est libre de toutes les contingences politiques locales. Le P.R.E. a adopté une démarche volontariste, nous sommes un des P.R.E. les plus dynamiques de France. À l’avenir, l’orientation du P.R.E. mettra l’accent sur la qualité des eaux et les constructions illégales.
