Existe-t-il plusieurs façons d’habiter ? Comment évoluent-elles ? Sophie Némoz est maître de conférences en sociologie et anthropologie à l’Université Marie et Louis Pasteur de Besançon, spécialisée dans la sociologie de l’habitat. Elle apporte son éclairage sur l’évolution de l’habitat, étroitement liée à celle de la société et de la prise en compte de l’environnement.
La sociologie de l'habitat est un domaine ancien qui étudie le lien social créé par l'habitat. Elle analyse les interactions entre les habitants, les professionnels du secteur et les politiques publiques. Ce champ d'étude dépasse les simples murs des constructions pour s'intéresser à la façon dont les individus et les groupes façonnent leur "chez-soi" et comment ce dernier suscite des interactions.

Plutôt que de parler de nouvelles manières d'habiter, on parle de recomposition, c'est-à-dire un nouvel assemblage d'éléments qui préexistent. Un exemple est le fait d'habiter sous le même toit sans lien de parenté, comme les "maisonnées" d'antan, souvent organisées autour d'une unité de production. Alors que le XXe siècle a vu la famille nucléaire devenir le modèle dominant, mes recherches montrent une nouvelle formation de maisonnées. Depuis le début du XXIe siècle, l'habitat intergénérationnel se développe en Europe, notamment en raison des difficultés d'accès au logement pour les étudiants et de la solitude et des contraintes économiques pour les seniors. Cet arrangement leur permet de conserver un logement, d'éviter la solitude et de retarder l'entrée en maison de retraite. Une autre tendance récente est le coliving, où des espaces locatifs privatifs sont proposés au sein d'un ensemble commun. Avec le vieillissement de la société, des associations mettent également en relation des seniors pour des colocations.
On assiste aussi à un fractionnement de l'habitat individuel. Le nombre d'unités habitantes n'a cessé d'augmenter, tandis que le nombre de personnes par habitant a diminué. Ce constat est en lien avec l'individualisation de nos sociétés. Cette multiplication des unités habitantes accroît la demande de logements, mais se heurte aux contraintes environnementales intégrées par les politiques publiques et à l'augmentation de la démographie. Ces facteurs interdépendants conduisent à une pluralisation des façons d'habiter. L'individualisation du logement favorise une grande diversité de schémas de vie, d'autant plus que nos sociétés sont devenues plus mobiles.
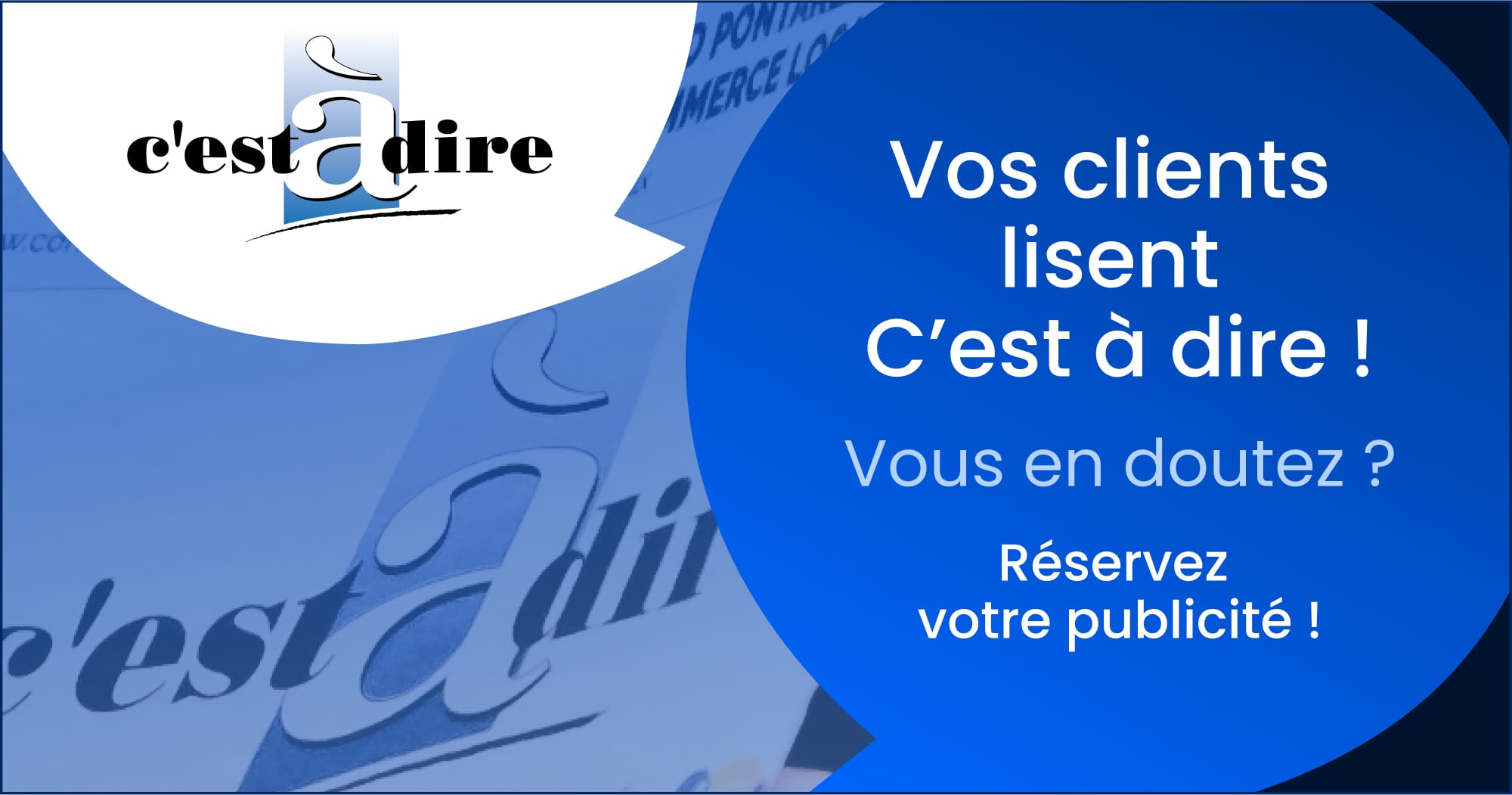
Cette pluralisation s'observe aussi bien en milieu urbain que rural. Il n'y a pas qu'un exode rural unilatéral ; on constate également un mouvement inverse, avec des gens s'éloignant des centres-villes.
Je travaille également sur l'influence des considérations environnementales sur la manière d'habiter, notamment les effets du changement climatique comme la sécheresse. J'étudie la fissuration des habitations, un phénomène techniquement appelé le retrait-gonflement des sols argileux. L'accélération et l'intensification des épisodes de sécheresse posent la question de comment habiter avec les phénomènes de catastrophe naturelle. Par ailleurs, les politiques publiques aspirent à réduire la pollution, et le bâtiment est l'un des secteurs les plus polluants. Les habitants souhaitent également vivre dans des logements plus respectueux de l'environnement, utilisant par exemple des matériaux biosourcés. Il s'agit de réduire l'impact de l'habitat sur l'environnement. Je mène aussi des recherches sur la justice sociale, pour comprendre comment l'injonction à prendre en compte l'environnement peut générer des droits et des inégalités entre les groupes sociaux. La sociologie de l'habitat est un domaine en constante évolution, avec des pratiques qui se transforment de plus en plus rapidement.
