Dès la mi-avril, une partie du Doubs s’est déjà retrouvée asséchée. Face à la vulnérabilité de la ressource en eau, accrue par le sol karstique, les autorités et la société civile se mobilisent pour préserver les milieux humides. Des actions sont notamment lancées du côté de Maisons-du-Bois-Lièvremont pour tenter d’améliorer le débit du Doubs. On a tous en tête le spectacle du Doubs ou de ses bassins totalement à sec, un scénario qui s’est hélas reproduit plusieurs fois ces dernières années. Alors que nous ne sommes qu’au printemps, comment aborder la situation ?

Les actions pour préserver l’eau ne stagnent pas
Alors que les milieux humides et la ressource en eau sont de plus en plus menacés, le département du Doubs montre une belle dynamique dans les projets de renaturation des cours d’eau, de réduction de la pollution ou encore de réhabilitation des systèmes d’assainissement.
L’image est devenue, hélas, habituelle. Le Doubs à sec laissant les roches et le fonds affleurer, visible à l’œil nu. Cette année, cet épisode de sécheresse du cours d’eau intervient tôt, en plein mois d’avril. À tel point que le préfet du Doubs n’a pas hésité dès le 10 avril à appeler à une vigilance et à la sobriété dans les usages de l’eau. « Malgré des cumuls de pluie cet automne et hiver 2024 globalement conformes aux normales de saison, les forts déficits de pluie observés depuis février, associés à la reprise de la végétation, des températures élevées et un vent régulier, impactent les niveaux des nappes et les débits des rivières. Depuis mi-mars, l’absence totale de pluie a conduit à une baisse très rapide de l’indice d’humidité des sols, qui est désormais proche des niveaux les plus bas observés pour la saison. Signe de cette fragilité, les écoulements du Doubs dans le Haut-Doubs sont très faibles », explique ainsi la Préfecture.

La ressource en eau dans le Doubs est fragile. D’autant plus vulnérable aux changements climatiques du fait du sol karstique qui recouvre une partie du département. Il y a deux ans, était lancé le Plan Rivières karstiques dont l’objectif est de retrouver une qualité des eaux tout en préservant la ressource en eau. Ce plan regroupe tous les acteurs de la politique de l’eau (Préfecture, Agence de l’eau, Département, E.P.A.G.E., etc.).
Contrôles des rejets des fromageries, contrôle de l’assainissement des stations d’épuration, travaux pour améliorer l’eau potable et assainissement, renaturation de cours d’eau… Depuis 2022, l’Agence de l’eau a apporté 20 millions d’euros d’aides sur le périmètre du Plan Rivières karstiques. « L’essentiel porte sur l’assainissement, entre 7 et 8 millions d’euros, note François Rollin, délégué de l’Agence de l’eau pour le Doubs. Les canalisations d’eaux usées, lorsqu’elles dysfonctionnent, génèrent des pollutions. Au lieu de ne capter que les eaux usées, elles captent aussi de l’eau pluviale. Lorsqu’il pleut trop, trop d’eau arrive à la station, plus que ce qu’elle peut traiter. C’est la problématique des déversoirs d’orage : le réseau d’eau déborde dans le milieu naturel sans traitement. Il arrive aussi que les réseaux d’eaux usées ne soient plus étanches et qu'ils agissent comme des drains. L’eau propre du sol est absorbée par le réseau d’assainissement. L’eau arrive à la station d’épuration un peu trop diluée, donc le rendement épuratoire est moins bon. »
L’autre volet des aides de l’Agence de l’eau, à hauteur de 5 millions d’euros concerne la réhabilitation de stations d’épuration, à l’image de celle d’Orchamps-Vennes (voir plus loin). « Il existe un règlement spécifique plus exigeant dans le Doubs. Les performances de traitement sont un peu rehaussées pour tenir compte de la sensibilité des milieux », observe François Rollin. 1,5 million d’euros ont été dédiés aux études et élaboration de schémas directeurs. « On manque parfois d’informations, il faut bien comprendre ce qu’on a sous les pieds, les réseaux souterrains. On n’accorde pas de financement si on n’a pas de schéma directeur. »
Les 6 millions d’euros restants portent sur des travaux de restauration des milieux à l’image de ce qui a été fait à la Rêverotte, le reméandrement du ruisseau de la Tanche à Morteau ou encore la restauration du profil morphologique du Doubs à Arçon (voir plus loin). « Dans le Doubs, le Conseil départemental s’est vraiment mobilisé depuis longtemps et de manière très forte sur cette problématique, relève François Rollin. Sur le territoire, la dynamique est très bonne, les services de l’État sont aussi très engagés. Il y a aussi une forte mobilisation de la société civile, ça nous oblige collectivement à agir. »
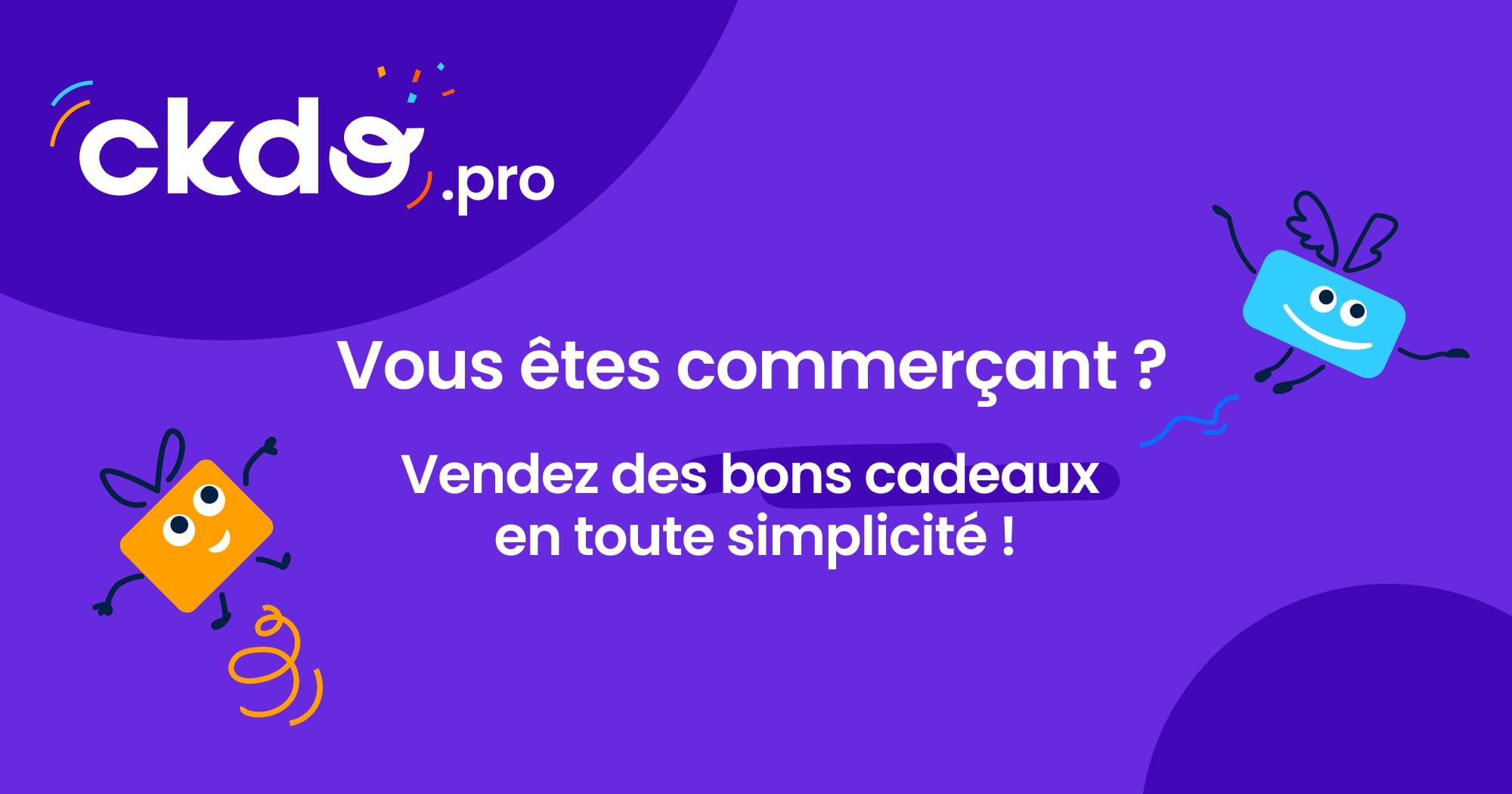
L’Agence de l’eau entame son 12ème programme d’actions sur 2025-2030. Au niveau national, plus de 2 milliards d’euros par an pourront être engagés pour accompagner les territoires face aux défis majeurs que constituent la restauration du bon état des eaux, la reconquête de la biodiversité et l’adaptation au changement climatique. Les capacités de financement des Agences de l’eau ont été augmentées de 25 %. « Le fait de prélever dans les milieux naturels et les nappes est plus taxé, cela concerne notamment les usagers industriels », précise François Rollin. Sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, 520 millions d’euros d’aides peuvent être mobilisés. Si ce 12ème programme se veut dans le prolongement du précédent, il monte tout de même en puissance avec un élargissement des aides. Les milieux en bon état intègrent dorénavant le champ de l’Agence de l’eau, les critères de sélection sont assouplis, le taux d’aide sur les restaurations des milieux passe de 70 à 80 %.
Seule nouveauté : le modèle séparatif des eaux (usées et de pluie) ne convainc plus vraiment. Les Agences de l’eau réfléchissent dorénavant à une infiltration des eaux pluviales sur place plutôt que de les canaliser et de les rejeter plus loin. Un concept pertinent en zones urbaines où beaucoup de sols sont imperméables. De manière plus globale, François Rollin prévient : la vocation incitative a été renforcée. Dans les communes où le système de collecte et de traitement d’eaux usées fonctionne mal, où le réseau d’eau potable fuit, les habitants paieront plus cher. Une manière d’encourager les élus qui ont des retards d’investissements à engager des projets et saluer les efforts des autres.
