Depuis 2008, en France, le nombre moyen de démissions de maires a été multiplié par 4 avec un pic à 613 en 2023. Le C.E.V.I.P.O.F. a mené l’enquête sur un phénomène sans précédent.
Alors que se profilent les prochaines élections municipales de 2026, le C.E.V.I.P.O.F. (Centre de recherches politiques de Sciences Po), a enquêté sur la démission des maires. L’étude publiée en juin dernier, met en évidence « un phénomène sans précédent ». Jamais en France les maires n’ont été aussi nombreux à rendre leur écharpe que pendant ce mandat. « Entre juillet 2020 et mars 2025, 2 189 démissions de maires ont été enregistrées par le ministère de l’Intérieur. Il ne se passe plus une journée en France sans qu’un édile démissionne. Le rythme a atteint un pic en 2023 avec 613 démissions », détaille Martial Foucault, professeur des universités à Sciences Po qui a piloté l’enquête.

Cette tendance n’est pas nouvelle, mais depuis 2008, elle n’a pas cessé de s’accélérer, jusqu’à devenir préoccupante. « En l’espace de trois mandats municipaux, c’est-à-dire entre 2008 et 2026, le nombre moyen de démissions de maires par an a été multiplié par 4 (129 contre 417) ».
Le phénomène concerne, en priorité, les petites communes de moins de 500 habitants. Mais il a pris une ampleur considérable, selon le C.E.V.I.P.O.F., dans les communes plus peuplées « qui font face à une vague de démissions sans précédent. Un maire démissionnaire sur quatre gouvernait une commune de 1 000 à 3 500 habitants (contre 13 % au cours du mandat 2008-2014) ». Les maires des communes de 10 000 habitants et plus sont moins visés puisqu’ils ne représentent que 5,5 % des démissions volontaires (4,1 % entre 2014 et 2018).
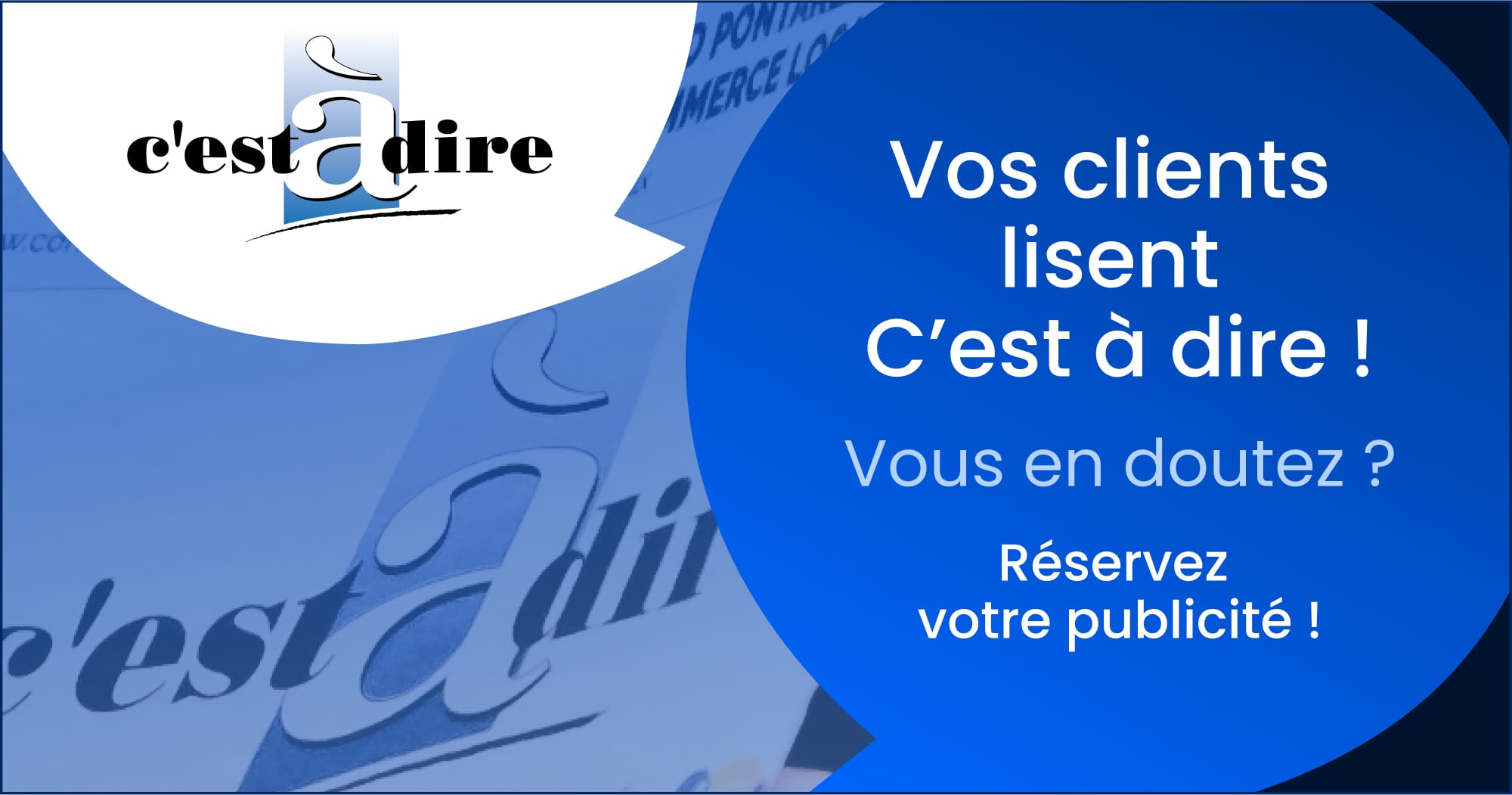
La première cause de démission est précisément liée à la taille de la commune où les querelles intestines qui naissent au sein des conseils municipaux finissent par décourager le maire qui jette l’éponge. « Avec 31 % des cas recensés, les tensions au sein du conseil municipal sont la principale cause de démission des maires. Leur décision de quitter leur fonction fait suite à des différends, disputes, conflits ou autres désaccords au sein du conseil municipal, tantôt à l’encontre des élus de l’opposition, tantôt, et c’est le cas le plus fréquent, au sein de la majorité » souligne le C.E.V.I.P.O.F.
La deuxième cause est la conséquence de la succession programmée. Elle intervient dans 13 % des démissions. C’est l’exemple du maire élu en 2020 qui annonce qu’il passera la main en cours de mandat pour diverses raisons. Viennent ensuite, les problèmes de santé qui poussent un maire à se mettre en retrait de la vie publique.
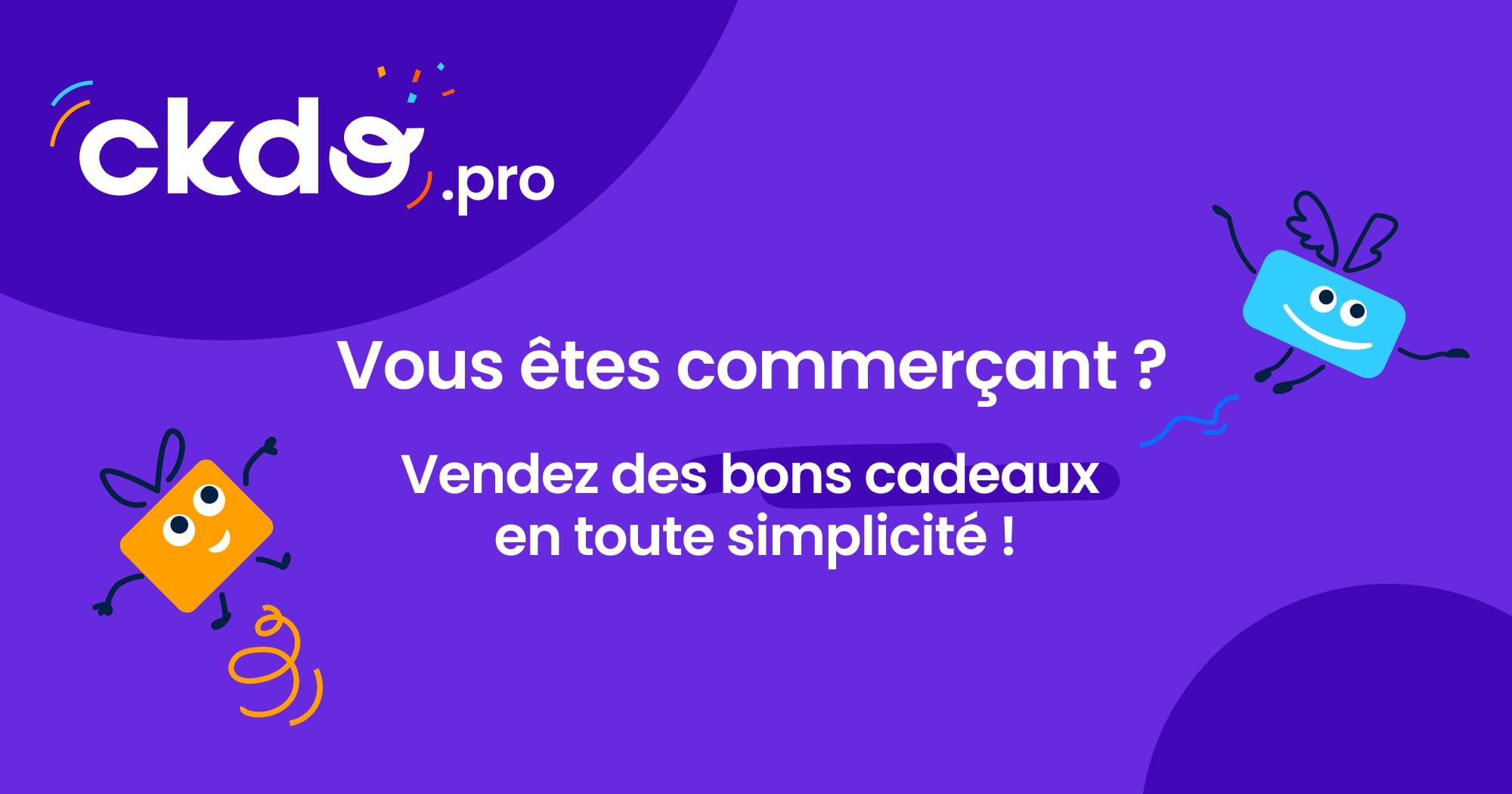
« Un changement de maire dans une commune ne signifie pas systématiquement démission, corrige Martial Foucault. Pour preuve, sur la période étudiée les motifs de changement de maires s’organisent autour de quatre familles : les démissions volontaires (71 %), les décès (21 %), les contestations juridiques de l’élection d’un maire devant le Tribunal administratif ou devant le Conseil d’État (3 %), les fusions des communes (2 %) et une catégorie disparate “autres” (3 %) ».
Il apparaît justement que dans cette catégorie « Autres », l’application de la loi de 2014 sur le non-cumul des mandats a conduit un nombre non négligeable d’édiles à choisir leur mandat de parlementaire ou d’exécutif départemental au détriment de celui de maire.
En écho à ces vagues de démission, le C.E.V.I.P.O.F. a questionné 5 200 maires afin de savoir combien d’entre eux sont prêts à se représenter en 2026. « 42 % des maires sortants déclarent déjà qu’ils comptent se représenter ». Un chiffre assez stable à six mois du scrutin (en 2020 ils étaient 48 %).
